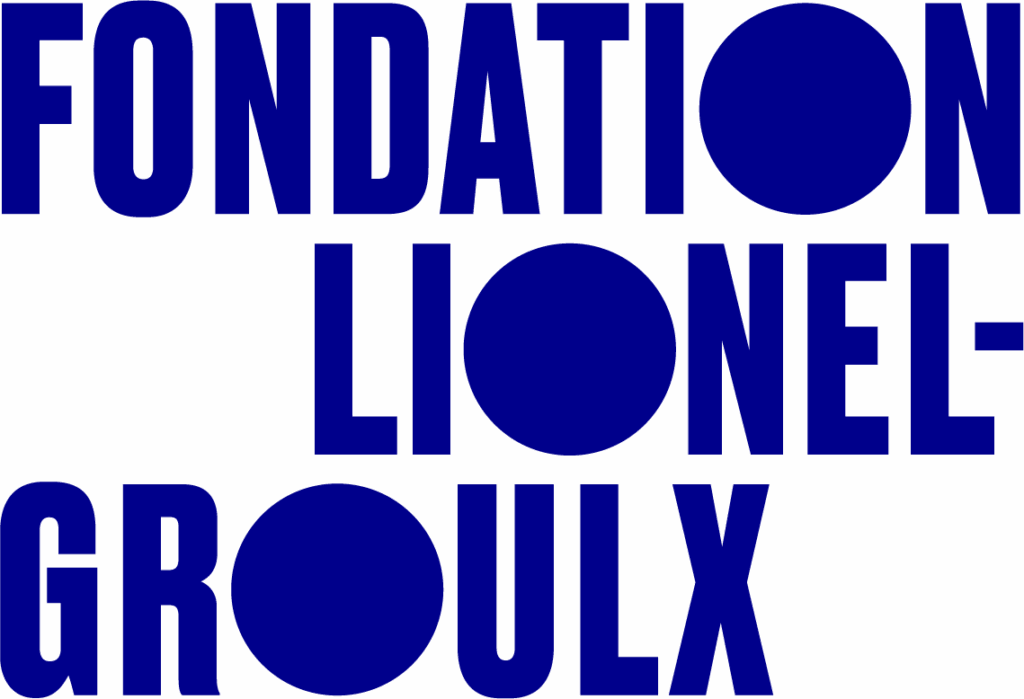
SOQUIJ apporte ici un éclairage jurisprudentiel sur l’une des «Douze lois qui ont marqué le Québec», telles que présentées par la Fondation Lionel-Groulx en 2024.
Dans une série d’entretiens organisés en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et QUB, la Fondation s’est intéressée à des lois du droit civil qui, depuis la Confédération de 1867, ont «structuré durablement le Québec comme société et nation uniques en leur genre».
En 1997, la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance est entrée en vigueur sous le mandat de la ministre Pauline Marois. Depuis, des milliers de parents ont pu en partie confier l’éducation et le bien-être de leurs enfants à des éducateurs. Cette loi a eu une répercussion considérable sur la société québécoise. Elle a permis de favoriser l’égalité des chances en facilitant, par exemple, l’inclusion des tout-petits en situation de handicap.
Les lois: remparts contre la discrimination
Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance
«2. Un enfant a droit de recevoir, jusqu’à la fin du niveau primaire, des services de garde de qualité, avec continuité et de façon personnalisée.»
Cet article a été repris dans la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, qui remplace celle de 1997. Il s’inscrit dans le combat contre la discrimination et, à l’opposé, pour le droit à l’égalité protégé à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Charte des droits et libertés de la personne
«10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.»
[Nos soulignés.]
Cette protection s’étend aussi lors de la conclusion d’actes juridiques s’ils ont pour objet un service ordinairement offert au public, comme les services de garde. Les centres de la petite enfance et les garderies ne doivent donc pas refuser d’accueillir un enfant sous un motif discriminatoire interdit, tel que le handicap.
«12. Nul ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public.»
Le Tribunal des droits de la personne précise que 2 autres éléments doivent être considérés pour que l’article 12 s’applique. «Dans un premier temps, [il faut que] la personne qui invoque la discrimination a[it] exprimé de manière suffisamment explicite sa volonté de bénéficier de ces biens ou de ces services. […] Il suffit qu’elle ait manifesté un intérêt sérieux pour ces biens et services et qu’elle ait concrètement accompli des démarches pour en bénéficier ou y avoir accès.
Dans un second temps, le Tribunal doit déterminer si la personne qui fournit ces biens ou ces services ou qui en contrôle l'accès a effectivement refusé de conclure un acte juridique à leur sujet. [...] Il n'est pas nécessaire que le refus soit toujours explicite, puisque différentes conduites plus subtiles peuvent, dans les faits, produire le même effet.» (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Pico) c. Centre Latitude Fitness inc., paragr. 45 et 46)
Qu’advient-il lorsqu’un enfant subit de la discrimination?
Bien que la charte québécoise protège le droit à l’égalité, il arrive parfois qu’un jeune enfant soit discriminé et exclu d’un milieu de garde. Le principe de l’accommodement raisonnable, élaboré par les tribunaux, peut s’avérer alors fort pratique afin de favoriser leur intégration. L’accommodement, bien qu’il soit utilisé principalement dans la sphère du travail à l’égard des employés appartenant à des minorités religieuses (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd.), trouve aussi sa place en matière de discrimination fondée sur le motif de handicap. Ce principe permet d’apporter des modifications à des règles de portée générale pour mieux inclure certaines personnes dans la société. Toutefois, si un prestataire de services de garde omet ou refuse d'implanter des mesures accommodantes, un tribunal pourrait déclarer qu’il y a une entrave au droit à l’égalité (Paré, Mona, «L'intégration rime-t-elle avec l'égalité? La versification en faveur de l'inclusion par le Tribunal des droits de la personne», dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Le Tribunal des droits de la personne: 25 ans d'expérience en matière d'égalité, volume 405, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015 [en ligne]).
Il importe de savoir que l’accommodement n’est pas un droit absolu, car, pour être appliqué, il doit demeurer dans les limites de la raisonnabilité. C’est ce que la Cour explique dans Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin:
«La notion d’accommodement raisonnable reconnaît que les personnes ayant une déficience ont le même droit d’accès que celles n’ayant pas de déficience, et impose à autrui l’obligation de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour tenir compte de ce droit. L’obstacle discriminatoire doit être éliminé, sauf s’il existe un motif justifiable de le maintenir, lequel peut être établi en prouvant que l’accommodement impose au fournisseur de services une contrainte excessive.»
[Nos soulignés.]
Pour savoir si l’obligation s’applique à une situation donnée, les tribunaux ont subordonné l’implantation d’accommodements à un test jurisprudentiel. Ce test a été adapté pour convenir dans les cas de discrimination pour motif de handicap en garderie. Il se divise en 3 critères.
D’abord, celui qui prétend être ostracisé doit démontrer qu’il y a une distinction reposant sur un motif de discrimination interdit. Les conditions suivantes doivent être réunies:
«1) une distinction, exclusion ou préférence;
2) fondée directement ou non sur un des motifs énumérés au premier alinéa de l'article;
3) qui a pour effet de compromettre ou de détruire le droit à l'égalité dans la reconnaissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne.» (Sivanathan c. Leduc, paragr. 20.)
Ensuite, il revient aux fournisseurs de services ordinairement offerts au public d’évaluer la personne discriminée de façon individuelle. L’évaluation doit prendre en compte ses capacités et ses besoins, en plus des mesures d’adaptation qui peuvent être appliquées raisonnablement. Si une telle évaluation n’est pas complétée, il sera en particulier difficile pour la partie défenderesse de justifier le refus d’aménager un accommodement.
Enfin, l’accommodement ne doit pas représenter une contrainte excessive. Dans le milieu éducatif, sont généralement considérées comme telles les mesures qui ne respectent pas l’intérêt de l’enfant handicapé, qui portent atteinte aux droits des autres élèves ou qui sont un enjeu financier trop important, en ce que la nature essentielle de l’entreprise ou sa viabilité seraient menacées (Paré, Mona, «L'intégration rime-t-elle avec l'égalité? La versification en faveur de l'inclusion par le Tribunal des droits de la personne», dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Le Tribunal des droits de la personne: 25 ans d'expérience en matière d'égalité, volume 405, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2015 [en ligne]).
Illustration jurisprudentielle du principe de l’accommodement raisonnable
Dans l’affaire Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Potter et autres) c. Petite Académie, des parents sont à la recherche d’une place en garderie pour leur enfant Félix. Ils informent une éducatrice, lors de la visite de la Petite Académie, que Félix est atteint d’hyperchylomicronémie. Cette maladie l’oblige à suivre une diète stricte restreinte en lipides. Il ne peut donc pas consommer les repas fournis par la garderie et doit apporter des lunchs de la maison. Cette situation ne semble pas problématique aux yeux de l’éducatrice à ce moment. Celle-ci indique aux parents qu’elle souhaite tout de même en discuter avec Mme Trudeau, propriétaire de la garderie. Quelques jours plus tard, les parents apprennent que la Petite Académie refuse d’accueillir l’enfant. Le refus est fondé sur le fait qu’il serait déraisonnable d’accommoder Félix. Selon Mme Trudeau, une éducatrice supplémentaire devrait être engagée et les repas préparés représenteraient un risque trop important pour les enfants ayant des allergies alimentaires.
Félix, à titre d’utilisateur du service offert par la Petite Académie, bénéficie de la protection de l’article 12 de la charte. Les démarches effectuées par la mère pour inscrire l’enfant à la garderie sont suffisantes pour conclure qu’elle a explicitement manifesté sa volonté d'avoir droit à des services de garde. De plus, le refus de Mme Trudeau s’appuie sur le handicap de Félix.
Cette discrimination repose sur un motif interdit, soit le handicap. Il y a donc aussi une atteinte au droit à l’égalité protégé par l’article 10 de la charte. Les 3 critères permettant de savoir si le refus d’accommoder discrimine Félix sont remplis.
Dans un premier temps, la demanderesse a établi par preuve prépondérante les 3 éléments nécessaires pour démontrer qu’il y a eu une distinction fondée sur un motif de discrimination interdit et qui a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et l’exercice d’un droit ou d’une liberté de la personne.
Dans un deuxième temps, la preuve ne révèle pas que Mme Trudeau a procédé à une analyse individualisée de la demande d’admission de Félix. Elle n’a pas cherché à comprendre la nature de la maladie en ne demandant aucun document médical explicatif. Elle pouvait alors difficilement prétendre que l’embauche d’une éducatrice supplémentaire aurait été nécessaire pour veiller au bien-être de Félix et des autres enfants. Ainsi, le deuxième critère n’est pas rempli.
Pour ce qui est du troisième critère, la défense de contrainte excessive proposée par Mme Trudeau n’est pas crédible en l’absence d’une analyse personnalisée. La partie défenderesse n’a pas réussi à prouver la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire et le fait que Félix aurait nécessité plus d’attention que les autres enfants. De même, elle n’a présenté aucune preuve à l’appui de sa prétention selon laquelle elle craignait pour la sécurité des enfants de la garderie qui souffraient d’allergies.
En conclusion, la discrimination découle du refus de la Petite Académie d’analyser individuellement le cas de Félix et de lui donner la chance, par l’entremise de ses parents, de démontrer qu’il était possible de l’accommoder sans contrainte excessive. Le droit à l’égalité de l’enfant, protégé par les articles 10 et 12 de la charte, est atteint.
La Petite Académie a été condamnée à payer la somme de 2 000 $ à l’enfant à titre de dommages moraux et punitifs.



